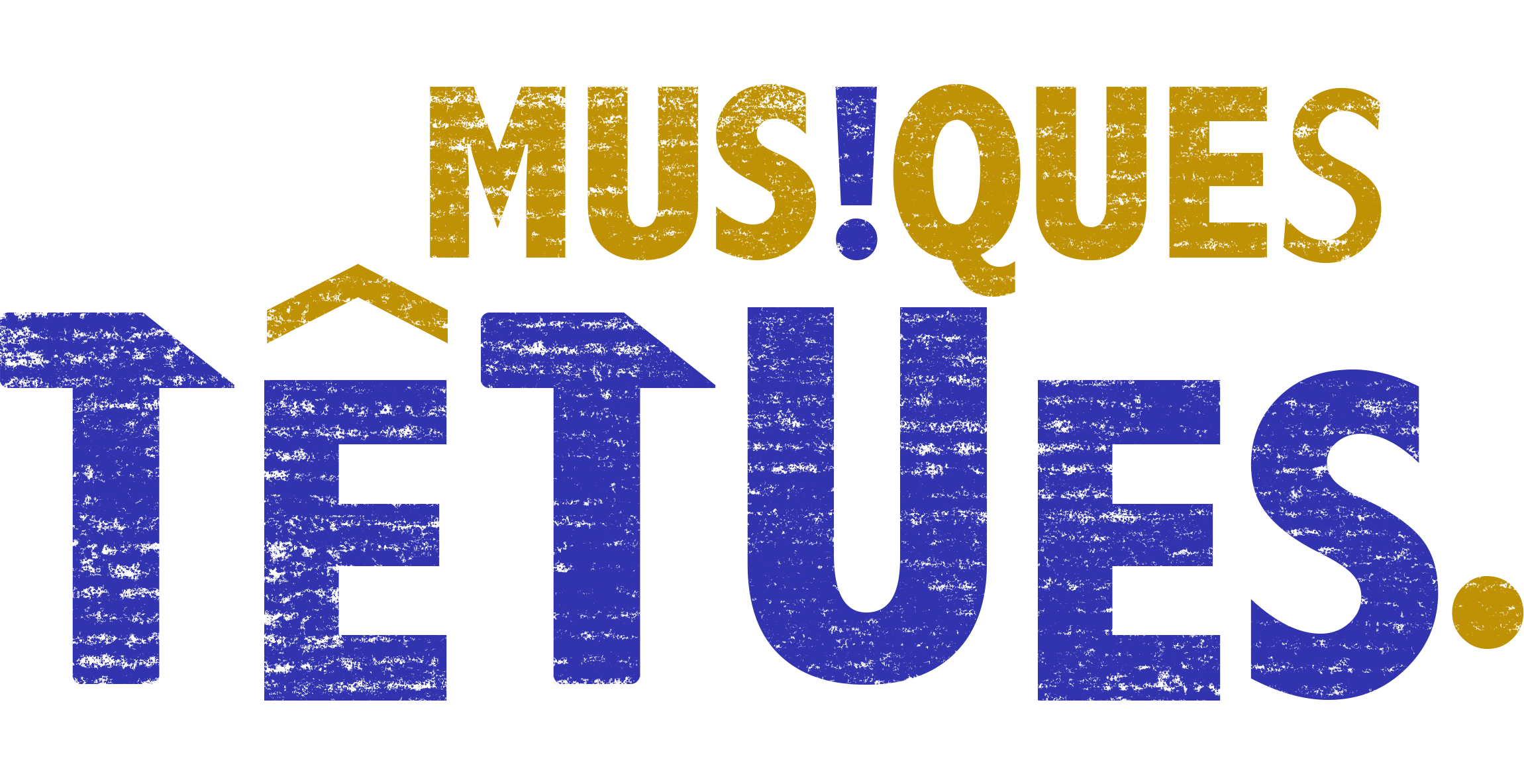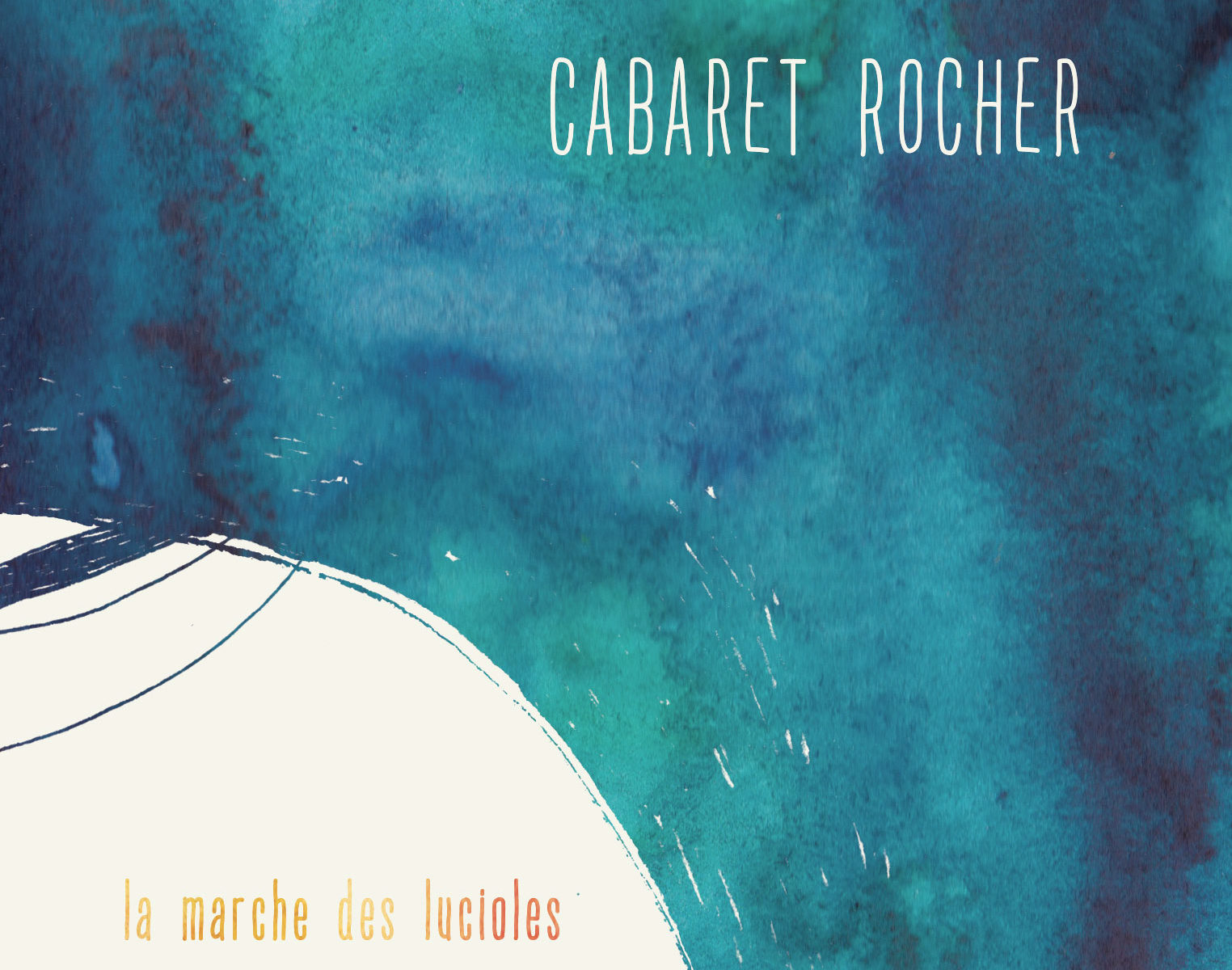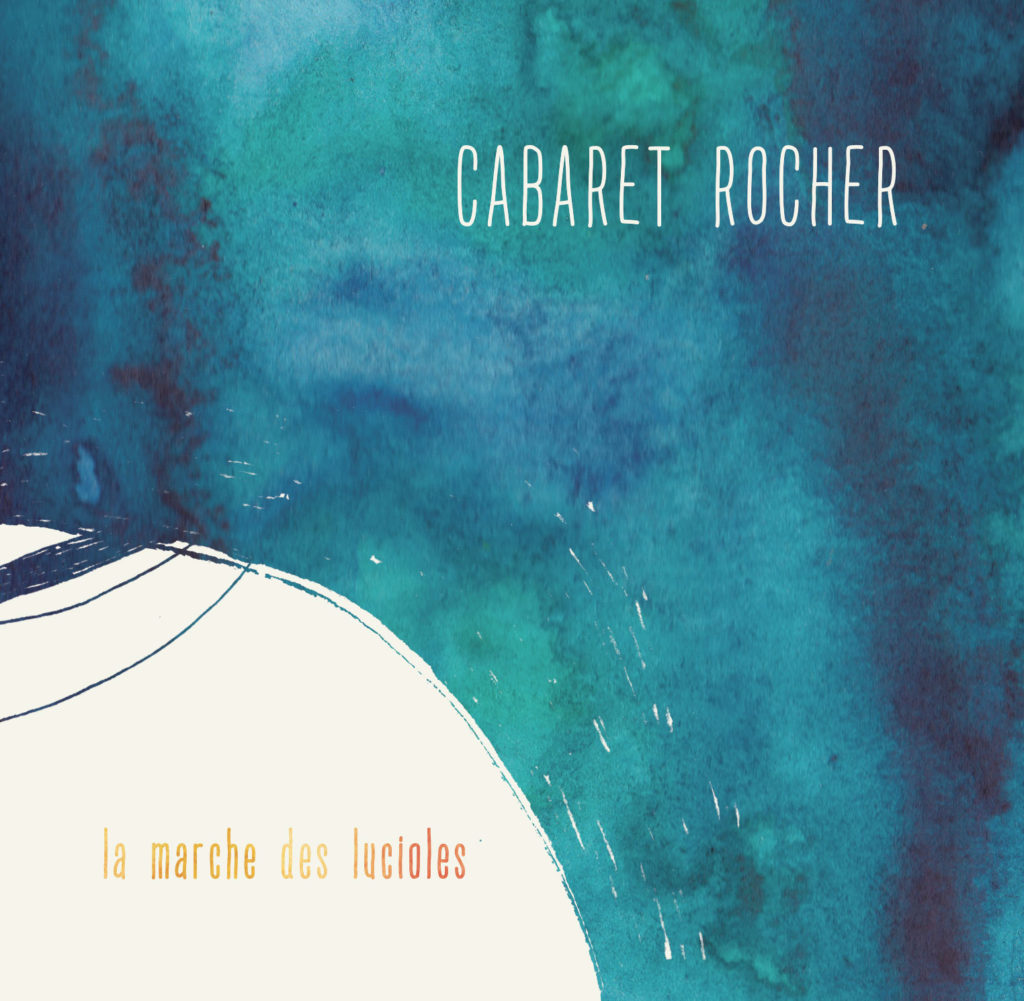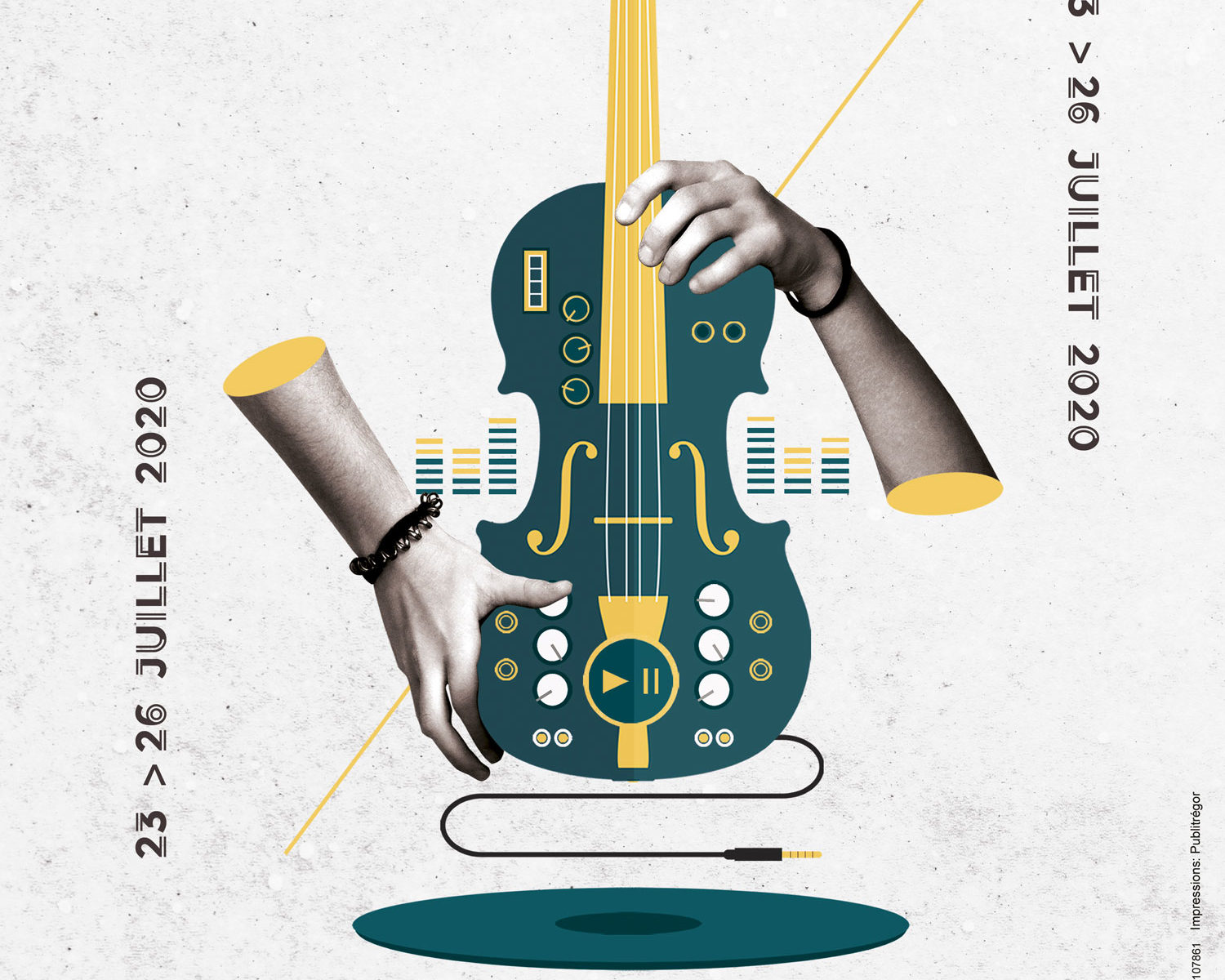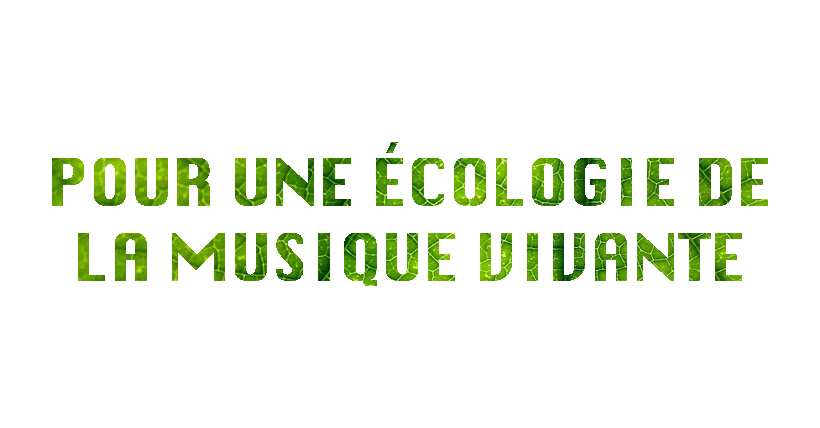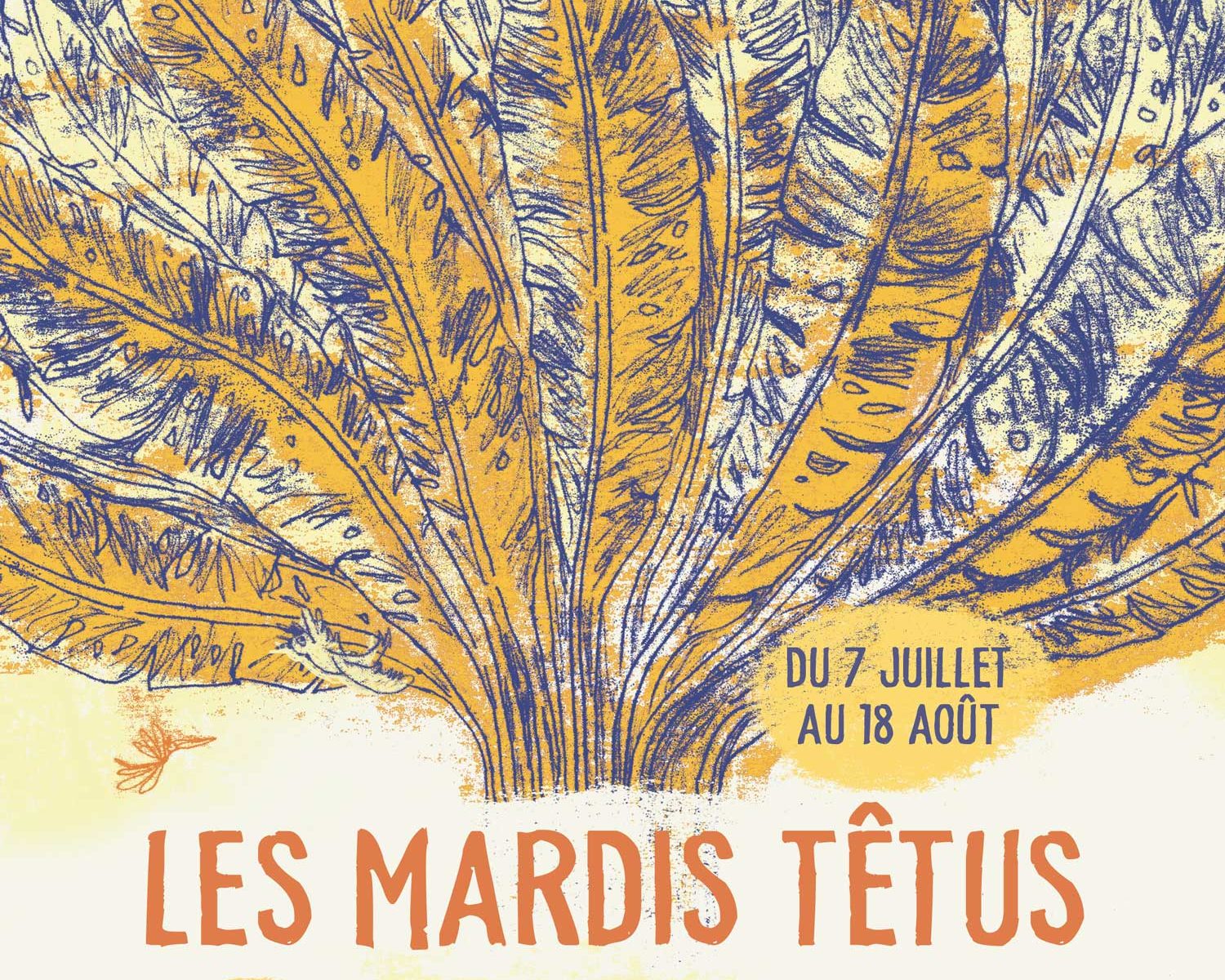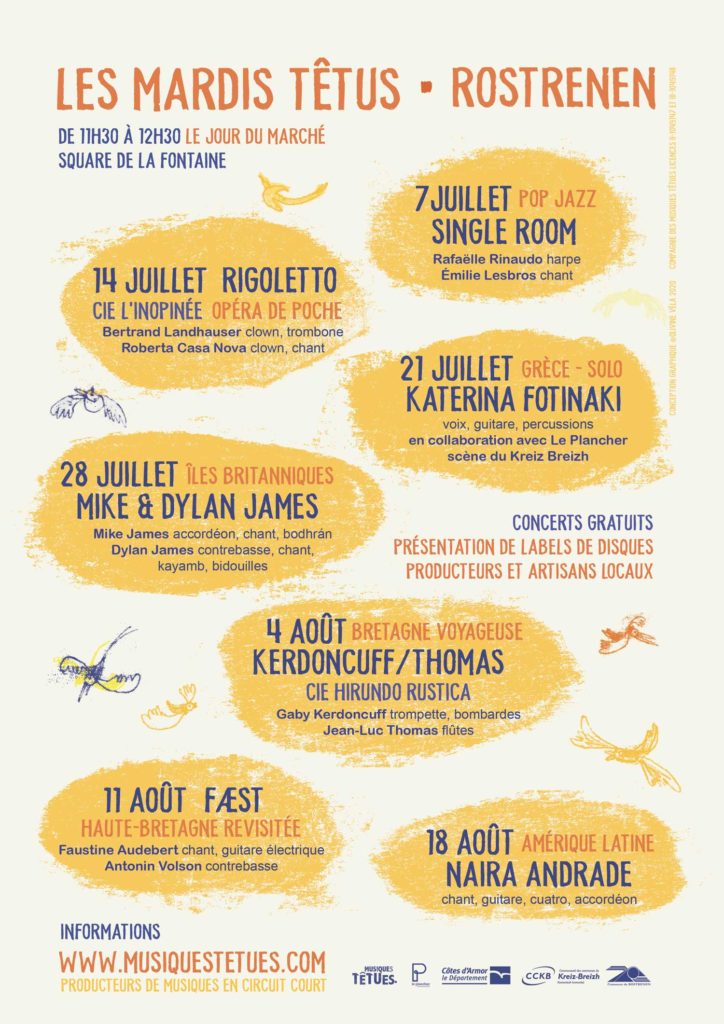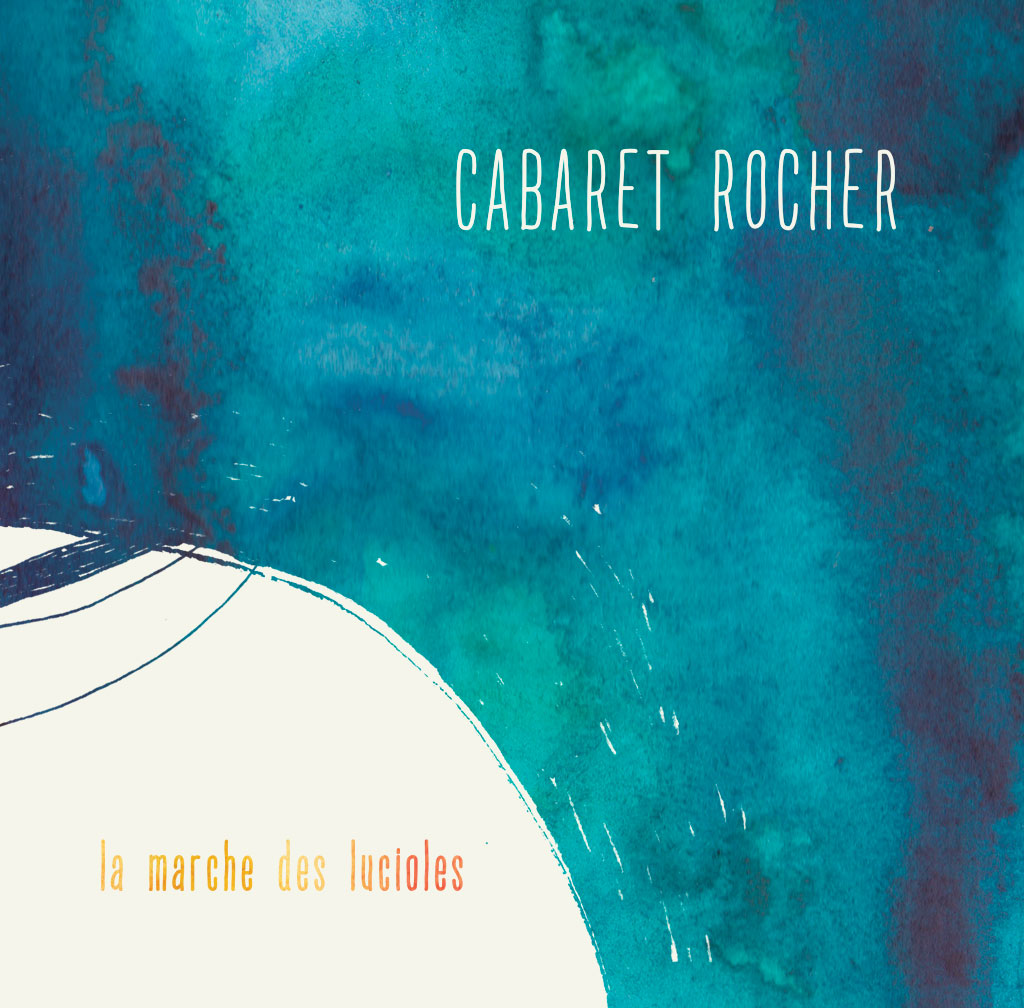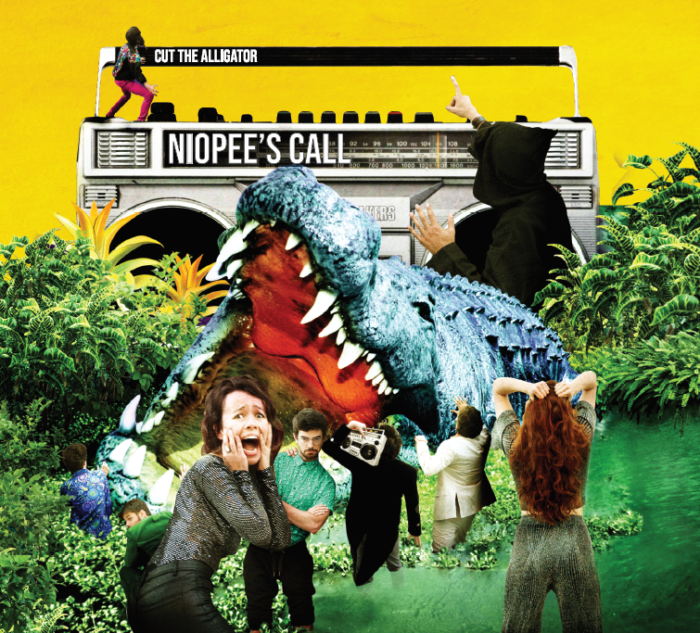A l’initiative d’un groupe de musicien·ne·s, des artistes, producteur·trice·s et professionnel·le·s du jazz et des musiques improvisées se sont réunis au printemps 2020 pour interpeller le secteur sur ses pratiques, ses modes de production et encourager un changement audacieux et vertueux afin de rendre nos pratiques professionnelles plus responsables et plus écologiques.
La compagnie des Musiques Têtues a signé ce communiqué.
Retrouvez la liste des signataires et les propositions pratiques ici
Appel des musicien·ne·s et des producteur·trice·s de musique engagé·e·s pour la transition écologique et la sauvegarde du vivant :
Nous, musicien·ne·s et producteur·trice·s de la musique
vivante, appelons l’ensemble des acteur·trice·s de la musique ainsi que
la puissance publique à prendre des mesures face à un constat sans
équivoque : nous entamons la sixième extinction massive de la vie sur
Terre – la première extinction délibérée de l’histoire de l’Humanité.
Car si les désastres passés et en cours sont irréparables,
nous voulons prendre aujourd’hui un virage audacieux et vertueux afin
de protéger notre écosystème terrestre, préserver la richesse et la
beauté du vivant.
L’écologie ne doit plus être considérée comme un label de bien-pensance mais une pratique collective et un engagement politique.
Nous devons transformer les usages de nos métiers et cesser de
considérer la planète comme une ressource inépuisable. Face à ce
constat, chacun doit faire sa part.
Cela implique le renoncement à certaines pratiques
au profit d’une vision à plus long terme, cela implique d’affronter les
dilemmes relevant de la responsabilité écologique qui se posent dans la
production du spectacle vivant.
Car aujourd’hui, les artistes et les producteur·trice·s vivent des injonctions contradictoires,
avec d’un côté l’exhortation à multiplier les représentations,
notamment à l’international (toujours plus loin, toujours plus visible)
et de l’autre l’exhortation des climatologues à limiter les émissions de
carbone et réduire la production de déchets.
Les artistes, les technicien·ne·s, les producteur·rice·s
partagent un réel dilemme : selon les usages aujourd’hui admis dans une
culture mondialisée, gravir les marches du succès implique de s’enfoncer
plus avant dans une course souvent énergivore – transports, matériel,
consommables – qui participe à détruire notre écosystème. Dans ce
contexte, réduire sa mobilité pour diminuer son impact écologique induirait ainsi de s’invisibiliser professionnellement.
Pour de jeunes artistes, cette prise de conscience est
d’autant plus amère qu’elle fait « renoncer » à un modèle global de
carrière qui ne semble plus viable ni responsable – mais qui malgré cela
continue d’être promu comme la référence dans l’inconscient collectif.
Les producteur·trice·s, quant à eux/elles, subissent une
double pression entre la nécessité de « faire du volume » afin de faire
tourner leur structure – multipliant parfois les concerts isolés et
événementiel à l’autre bout du monde -, et la pression exercée par les
artistes qui voient en eux « l’homme ou la femme providentiel·le »
censés les mettre en lumière et développer leur carrière.
Enfin, la mise en réseau n’est pas encore une logique
suffisamment partagée par les diffuseurs – lieux et festivals – qui sont
amenés à concentrer leurs efforts sur la promotion de leurs événements
propres sans toujours s’inscrire dans une démarche de coopération qui
permettrait de grouper les concerts. Par ailleurs, certains s’échinent à
une course à la communication (teasers, goodies, accessoires des
sponsors) et construisent une programmation souvent éloignée de leurs
aspirations premières, tant la pression économique est patente.
Nous devons changer de paradigme, écrire de nouveaux récits
: le modèle de l’artiste “star” – dont la valeur est calculée au nombre
de tournées dans l’année, de spectateur·rice·s, de disques vendus
(réels ou dématérialisés) ou encore à la taille et au prestige des
salles de concert ainsi qu’à l’opulence de ses productions – est tout
simplement incompatible avec une société où la justice écologique doit
se substituer à la logique économique.
Il est temps de changer de modèle.
Nous devons revaloriser, symboliquement, l’artiste qui
agit localement : tissant des réseaux de partage sur son territoire,
faisant germer des foyers de créativité dans toutes les strates de la
population et construisant des projets au long cours et des
collaborations pérennes avec les lieux et les habitant·e·s d’un même
territoire.
Tout comme nous croyons à la relocalisation des
industries et des entreprises, nous croyons également à la
relocalisation de notre art.
L’objectif n’est pas de se couper du reste du monde ni de
la richesse des échanges interculturels mais de les renforcer en les
appréhendant sous l’angle de l’immersion : au lieu de promouvoir
des concerts uniques et isolés, privilégions les projets de longue durée
accompagnés d’actions artistiques et culturelles dans le pays
d’accueil.
Nous devons redonner à l’acte de voyager son caractère exceptionnel et précieux en menant des projets dont la valeur viendra aussi de la rareté.
Enfin, nous devons sortir de « l’obsolescence programmée » des créations
: chaque année un nouvel album, un nouveau projet, une nouvelle
création… qui conduit à une certaine précipitation et une surproduction
généralisées, à tous les échelons.
Il n’est pas hasardeux de penser que la Culture pourrait
subir plus tôt que prévu les impacts directs du changement climatique :
les canicules, pandémies, inondations et autres événements climatiques
violents se systématisant, les assurances ne couvriront plus certains
événements. Que ferons nous par exemple sans tous ces festivals d’été
qui représentent une part colossale de l’activité culturelle et de
l’économie du spectacle vivant ?
Le virage ne pourra pas être entrepris par les artistes seuls : nous appelons aujourd’hui à
une convergence des acteur·rice·s de la musique ainsi qu’à la mise en
place d’une politique publique pour une écologie de la musique vivante.
ARTISTES, TECHNICIEN·NE·S, LIEUX, SALLES, THÉÂTRES, FESTIVALS, PRODUCTEUR·RICE·S, MANAGEUR·EUSE·S, JOURNALISTES, ATTACHÉ·E·S DE PRESSE, FINANCEURS PUBLICS ET PRIVÉS,
TRAVAILLONS ENSEMBLE À OPÉRER CES CHANGEMENTS MAJEURS
Aussi, nous soumettons des propositions détaillées que
nous souhaitons discuter avec tou·te·s les acteur·rice·s du secteur, en
particulier les interlocuteurs publics et parapublics (État,
collectivités, sociétés civiles, fédérations, etc.) afin que chacun
puisse avancer, à sa manière mais résolument, vers des pratiques et des
modes de production plus responsables.
Ces prévisions doivent reconfigurer urgemment nos perspectives : n’attendons pas d’être au pied du mur pour imaginer un art vivant qui soit aussi art du vivant.